30 juin 2025
Attestations fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons
Lire la suite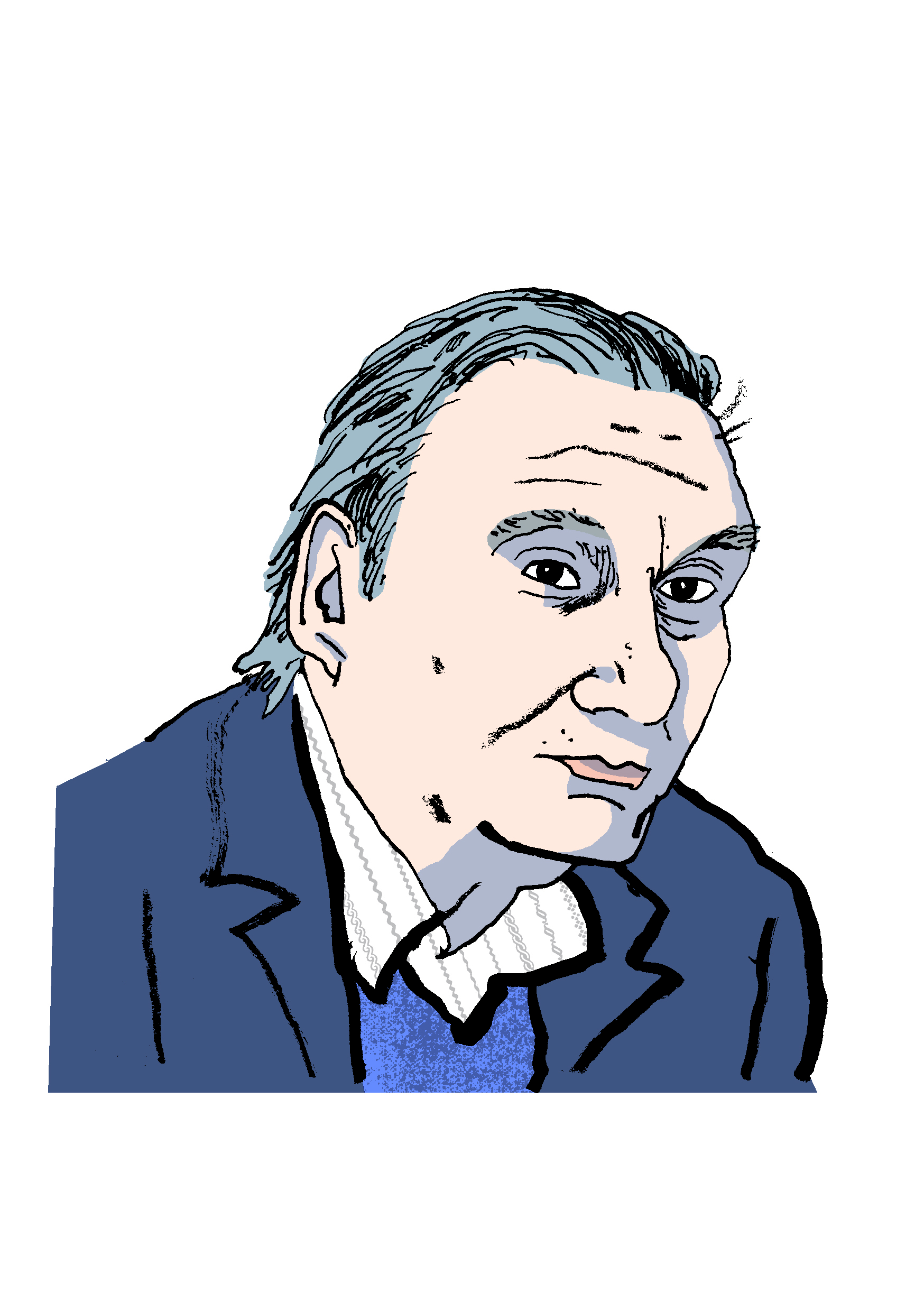
11 janvier 2021

« Depuis les indépendances en Afrique de l’Ouest, au début des années 60, les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ont joué un rôle majeur dans la construction des politiques nationales », constatent Dominique Gentil et Jean-Jacques Gabas dans l’édition annuelle 2020-2021 de Défis Sud.
L’indépendance n’a jamais vraiment été acquise en termes de formulation des politiques et de budgétisation des actions. Les politiques publiques nationales ont suivi l’évolution des paradigmes des bailleurs de fonds. La France, en tant qu’ancienne puissance coloniale a continué à jouer un rôle important dans la formulation des politiques, même si son influence a tendance à se réduire
Qu’est-ce qui explique l’absence de prise en main complète des politiques publiques ?
« Les hommes d’État qui avaient une vision ont été mis à l’écart ou assassinés, tel que Thomas Sankara, président du Burkina Faso, mis à mort en octobre 1987 », commente Dominique Gentil. « Dès lors, Il n’y a pas eu de cadres nationaux africains qui proposaient des véritables pensées alternatives. Les bailleurs de fonds voulaient débourser leur argent. S’ils ne trouvaient pas d’interlocuteur, ils imposaient leurs normes ».
En septembre 1965, Dominique Gentil est affecté par l’Iram [1] au Niger, où il passera cinq ans :
« Au Niger, témoigne-t-il, après 60 ans de colonisation le taux de scolarisation était de 4 % et il y avait donc très peu de cadres nigériens. Les quelques Nigériens qui avaient suivi une instruction pour devenir instituteurs ont été appelés pour diriger le pays. Cela pouvait sembler surréaliste à certains, mais cela permettait quand même une certaine proximité entre les responsables et la population. Les Nigériens qui avaient travaillé en zone rurale durant la colonisation française connaissaient très bien le milieu rural. Dans un second temps on a assisté au retour au pays des Nigériens étudiants boursiers qui avaient passé plusieurs années dans des universités françaises, mais entretemps ils s’étaient déconnectés du monde rural, ils avaient perdu leur connaissance profonde des villages. »
C’était en quelque sorte l’intrigue de L’Aventure Ambiguë, un roman de Cheikh Hamidou Kane publié en 1961, qui se vérifiait dans la réalité. Ce roman est l’histoire d’un jeune homme qui passe de l’école coranique à l’école des Blancs, afin d’apprendre cet art de «vaincre sans avoir raison».
« Ce roman posait déjà la question de ce qui avait été appris et perdu avec la colonisation », explique Dominique Gentil. « La compréhension de la modernité était d’imiter l’Europe. Les parents voyaient que pour que leurs enfants progressent, il fallait qu’ils aient de bons résultats scolaires dans un système calqué sur celui de la France. Tout enseignement trop proche d’une réalité rurale dont ils aspiraient extraire leurs enfants était de l’enseignement au rabais pour eux, qui n’offrait pas de débouchés. »
La ruralité fut donc dévalorisée durant les trois premières décennies de l’indépendance.
« Au Mali, le début d’expérience démocratique avec l’élection d’Alpha Oumar Konaré en 1992, ouvrira la voie à une première décentralisation et à une prise en compte des autres acteurs paysans sur le terrain », rappelle Jean Jacques Gabas, « Mais il faudra attendre quelques années encore avant que les représentants des paysans, au travers de leurs fédérations paysannes, aient droit au chapitre dans la formulation des politiques ».
« Au début des années 80, précise Dominique Gentil, la Banque mondiale avait mis en place un programme dénommé “ Formation et Visites ” (Training and Visit) qui prévoyait un effet “ feedback ” des paysans qui devaient donner leur opinion. Mais en réalité, on ne les écoutait jamais. Daniel Benor, un consultant israélien, était parvenu à convaincre les économistes de la Banque mondiale d’engager des vulgarisateurs qui visiteraient régulièrement les groupes de paysans. Ceux-ci pouvaient s’exprimer et leurs questions seraient répercutées au niveau national. Il était promis que les rendements agricoles croissent rapidement. Mais il s’est vite avéré qu’il s’agissait surtout de proposer des innovations pas forcément meilleures que les pratiques paysannes. Malgré de nombreuses controverses sur la méthode de “ Formation et Visites ”, auxquelles je participais par la rédaction de nombreux articles critiques, la Banque persévéra dans cette approche et ne reconnut son erreur qu’au début des années 2000. »
À partir des années 80, les Plans d’ajustement structurels (PAS) du FMI et de la Banque mondiale démantèleront le peu de soutiens publics qui étaient attribués aux paysans. Ceux-ci seront contraints de s’organiser pour défendre leurs intérêts. L’émergence de fédérations d’organisations paysannes sera donc un effet collatéral des PAS.
Dominique Gentil : « Les paysans démontreront qu’ils sont capables d’aller manifester, de se battre pour exiger d’être représentés dans telle commission, tel comité. Les organisations paysannes ont parfois été confrontées à des discours leur faisant miroiter un pouvoir qu’elles n’ont pas eu. Elles n’ont pas toujours été accompagnées et les financements n’ont pas toujours suivi. Pour que les décisions puissent être prises par les intéressés qui connaissent le terrain, il faut encore davantage délier les cordons de la bourse. Mais dans l’ensemble, les organisations paysannes ont prouvé qu’elles peuvent organiser des circuits de production, des circuits commerciaux et des chaînes d’approvisionnements qui fonctionnent. Elles ont également appris à faire pression sur leurs gouvernements pour exiger une protection face aux produits importés. »
Jean Jacques Gabas souligne que « l’élaboration de la Loi d’orientation agricole au Mali au début des années 2000 a relativement tenu compte des revendications des OP. Mais les financements restent à ce jour trop dépendants du suivi des modèles agricoles imposés par les grands bailleurs, anciens ou nouveaux (tel que la République populaire de Chine), tous orientés par une vision du développement agricole conforme à l’agrobusiness. »
À cet égard Jean Jacques Gabas regrette le démantèlement progressif des contenus les plus intéressants des Accords de Lomé (1975) et de Cotonou (2000). Ces accords associaient des aspects commerciaux et préférentiels. Ils étaient discriminatoires au sens positif du terme pour tenir compte du fait que les États, notamment d’Afrique de l’Ouest, étaient dans des situations d’asymétrie très fortes, qu’ils ne pouvaient pas se lancer sur un marché mondial où ils seraient perdants, où les gains de productivité étant absolument incomparables. L’Accord de Lome contenait des outils de politique de développement intelligents tels que le Stabex, un processus de stabilisation des exportations… Mais les accords de l’OMC et les visions très libérales sont passées par-là. On a considéré que les États n’avaient pas de rôle à jouer sur la régulation des marchés internationaux en négociant des Accords de partenariats économiques ultra-libéralisés qui provoquent une très forte porosité économique.
Dans ce contexte, selon Jean-Jacques Gabas, « il ne faut surtout pas faire une croix sur les efforts d’intégration régionale entrepris par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) créée en 1975. Les États en Afrique de l’Ouest ne vont pas s’en sortir seuls. Il faut absolument qu’ils construisent leurs politiques ensemble. Cela peut prendre du temps avant qu’une intégration régionale ait des effets sur le bien-être des populations. Mais c’est une nécessité de continuer à négocier la construction de l’intégration, car il faut mettre en place des infrastructures et des chaînes de valeur régionales, tout en sachant aussi qu’il existe des difficultés inhérentes à la région, avec des États dans des situations extrêmement différentes en termes de puissance économique. Le Nigeria et le Ghana ont peu à voir avec le Togo et le Mali. Ces entités se construisent dans la difficulté, mais cette construction est nécessaire sachant qu’elle devra être intégrée dans le vaste projet de zone de libre-échange. In fine, il faut surtout des lieux de négociation dans lesquels on tienne compte des organisations paysannes, principalement représentées, depuis le début des années 2000 par le Roppa, le Réseau des organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest ».
Une réalité est restée invariable : la majorité des populations de l’Afrique de l’Ouest habite dans les zones rurales, vit de l’agriculture et diversifie ses activités. La petite agriculture familiale domine. Elle est reliée à des organisations paysannes, avec des systèmes de crédits parfois reliés à la diaspora.
Selon Dominique Gentil, les dynamiques qui se sont construites autour de ces activités paysannes sont les plus belles réussites depuis les indépendances :
« Parmi les choses intéressantes et qui sont utiles aux paysans, il y a la microfinance et les coopératives d’épargne et de crédit dans toute l’Afrique de l’Ouest. Contrairement aux idées reçues il peut exister de l’épargne et du crédit en Afrique. Quand l’épargne est collective, les membres de la collectivité qui ont contracté un crédit remboursent, parce qu’ils savent qu’ils se voleraient eux-mêmes s’ils ne remboursaient pas. »
Ces dynamiques permettent aux paysans de développer leur imagination, de se lancer par exemple dans la transition agroécologique, si on leur en donne les moyens.
D’après Jean-Jacques Gabas, « les agriculteurs ont parfaitement compris comment faire face à la vulnérabilité de leur économie. Ils sont nés dans la vulnérabilité, ils savent que leurs écosystèmes sont fragiles. Dans les années 30 déjà, il y avait des sécheresses. Les paysans adhèrent donc naturellement à la transition agroécologique leur permettant de faire face à leur vulnérabilité, mais il faut quand même qu’ils aient quelques moyens. »
« Or, poursuit Jean-Jacques Gabas, il s’agit d’être vigilant envers les bailleurs qui affirment faire de la transition agroécologique. Il existe une certaine ambiguïté dans les discours, on donne d’une main ce qu’on retire de l’autre en favorisant des projets d’agriculture industrielle dans la vallée du fleuve Sénégal ou dans la zone de l’Office du Niger au Mali. Aujourd’hui la politique chinoise est à la tête de la FAO. Cette organisation internationale construit des paradigmes de développement. Le nouveau directeur général de la FAO affirme être favorable à la transition agroécologique, mais quand on écoute attentivement ses discours, on entend que le développement agricole en Afrique n’aura lieu que si vous y mettez la 5G et que si vous y intensifiez le recours aux intrants et aux engrais. Pourtant, plusieurs études et recherches ont démontré que la vie des paysans et leur contexte socio-économique n‘incitent pas à faire de l’intensif. Mais ces analyses sont inaudibles. Les responsables au sein des ministères en Afrique de l’Ouest sont ouverts à tout, à quelques projets de l‘agroécologie certes, mais aussi à des semences sélectionnées et améliorées… Quand nous arrivons avec nos idées de biodiversité, on nous écoute poliment, on nous dit oui, mais les financements ne suivent pas. »
« Ce qui est intéressant, complète Dominique Gentil, c’est que les OGM ont fini par être rejetés dans certains pays. Au Burkina, à la suite des expériences avec le coton OGM, les paysans se sont aperçus que ça rendait les plantes plus fragiles, n’augmentait pas le rendement, coûtait plus cher et diminuait les revenus. Les faits étaient vérifiables. Certains paysans ont commencé à se battre contre le coton et le mouvement a pris de l’ampleur… Il faut que les organisations paysannes soient capables d’avoir un discours se basant sur des faits et prouvent qu’il ne faut pas continuer dans les voies tracées par l’agro-industrie. »
Aujourd’hui en Afrique de l’Ouest, des zones gigantesques échappent à l‘autorité des États.
Dominique Gentil en est catastrophé : « Dans la situation actuelle, comme les gens ne peuvent plus aller sur le terrain, ils ne peuvent même plus comprendre. Ou bien vous avez un temps d’expérience antérieure, vous savez certaines choses, mais dans la majorité des cas, un jeune qui est recruté par l’aide et qui n’a jamais fait de terrain, il ne va rien comprendre. »
« L’épilogue paraît dramatique et pourtant, l’insécurité ne date pas d’aujourd’hui », note Jean-Jacques Gabas. « Dans les années 2000, les autorités nationales et internationales étaient parfaitement au courant que le nord du Mali devenait la plateforme d’une forme de banditisme international. Personne n’a rien fait et, évidemment, une partie de la population a trouvé son compte dans les trafics mafieux».
« Les djihadistes ont pu instrumentaliser ces zones de non-droit au profit de leurs objectifs idéologiques ».
Jean-Jacques Gabas pense que le faible appui aux communautés paysannes de ces régions ne suffit certes pas à expliquer l’insécurité actuelle. Mais cette faiblesse doit être intégrée parmi les multiples causes : « Les statistiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE nous indiquent qu’en 1975 l’Aide publique au développement qui était octroyée à l’ensemble du secteur agricole atteignait à peu près 5 milliards de dollars. Je parle de l’aide globale dont une grande partie est quand même destinée à l’Afrique. Cette aide croîtra jusqu’à 8 milliards de dollars en 1985 pour revenir à 5 milliards de dollars en 2008. Depuis, la courbe augmente petit à petit mais on n’a jamais rejoint les 8 milliards de 1985. Ces statistiques indiquent que le secteur rural, à défaut d’être totalement délaissé, n’a été appuyé que sur des zones de niche, de très vastes régions ont été complètement délaissées. Sur 60 ans, le monde rural reste le parent pauvre du financement du développement. »
Les rapports du programme RuralStruc sur les transformations rurales dans les pays en Afrique de l’Ouest ont montré de très grandes disparités entre les régions, parfois dans un même pays. « Et lorsque vous avez de telles inégalités entre la métropole et les zones rurales, lorsque des gens sont dans des trappes à pauvreté depuis des décennies, à un moment donné et fatidique, le premier dollar qui arrive est bon à prendre, même si c’est un dollar jihadiste » conclut Jean-Jacques Gabas.
Propos recueillis par Pierre Coopman.
Articles réalisés par :
[1] Institut de recherche et d’application des méthodes de développement.